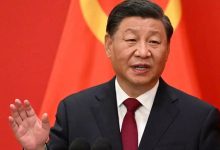Ismaël, un artiste arpenteur du monde (portrait)

Le cinéaste, poète, photographe et vidéaste tunisien, Ismaël, était artiste associé du festival Masnaâ, qui s’est déroulé à Casablanca, du 9 au 16 mai 2016. Des extraits de films documentaires ont été projetés à la Source du Lion, tirés du film Babylon, grand prix au Festival international de Marseille (FID), en 2012. Consacrés à la situation des réfugiés libyens dans le sud de la Tunisie, ces extraits étaient accompagnés de la projection de rushes d’un travail en cours consacré à la situation des réfugiés syriens, au Liban.
Ce qui frappe d’emblée le spectateur est le parti pris radical du réalisateur qui, dans Babylon, choisit de ne pas sous-titrer son film pour laisser entendre les voix d’une dizaine de nationalités ayant fui, pour la plupart, la Libye, à l’époque de la guerre. Pour l’essentiel d’entre eux, il s’agit de travailleurs en provenance de pays asiatiques ou africains qui se retrouvent ipso facto apatrides alors que de leur côté, les ressortissants fortunés de la bourgeoisie libyenne trouvent refuge en Tunisie, arrivant à se loger et à vivre sereinement.
Un monde sans frontières ?
La question de la frontière tient à cœur au cinéaste qui avoue ne se reconnaître dans aucune forme de délimitation ou de territoire définitivement figé. Ainsi explique-t-il le choix de son pseudonyme, Ismaël, nom attribué par son grand-père qui deviendra son nom d’artiste, comme un refus de n’appartenir qu’à une seule famille, une seule nation, une seule communauté.
A l’heure où les réseaux sociaux imposent une tyrannie de la proximité virtuelle, Ismaël met en avant le paradoxe de nos sociétés spectaculaires qui n’ont de cesse de rejeter l’autre, le réfugié fuyant la guerre et la dévastation. En témoigne l’amalgame fâcheux que l’on ne cesse d’établir, en Europe notamment, entre la question des migrants et celle des réfugiés, protégés par des conventions internationales et de ce fait, ayant des droits inextinguibles.
« L’art est politique »
Ismaël appartient à une jeune génération d’artistes tunisiens, cultivés, contestataires et novateurs. Expérimentant des formes cinématographiques et artistiques inusitées, en marge de ce qu’un protagoniste du documentaire de Ridha Tlili, Révolution moins 5 minutes, projeté durant le festival, appelle « l’art de l’autorité », par opposition à un art de la nouveauté et de l’innovation. Ismaël a ainsi réalisé un court-métrage intégralement via Skype.
De son côté, le festival Masnaâ a présenté différents travaux de plus ou moins jeunes artistes formant un collectif qu’Ismaël a regroupé sous le nom de « Politiques », au pluriel souligne-t-il, pour rappeler que le geste artistique, quel qu’il soit, a toujours une portée sur la vie de la cité. « N’importe quelle superproduction hollywoodienne fonctionne, ajoute-t-il parlant de cinéma, car elle est idéologique ». Et de fait, les artistes qu’Ismaël a choisi de programmer, en compagnie de David Ruffel, interrogent pour la plupart l’instant révolutionnaire, cette vacance du pouvoir et cette aventure des possibles qui rendent ce moment à la fois porteur de toutes les menaces et de tous les espoirs. L’exposition « Intension », visible jusqu’au 4 juin à la Galerie Venise Cadre de Casablanca, regroupe ainsi les œuvres de dix artistes marocains ou tunisiens, tous nés dans les années 80, parmi lesquels on citera le plasticien Fakhri El Ghezal, Nidhal Chamekh et le vidéaste Malek Gnaoui.
Vivre ou regarder la révolution ?
Dans le documentaire Révolution moins 5 minutes, de jeunes artistes de street art, qui se sont baptisés « Le peuple de la caverne », débattent avec virulence de la place de l’artiste dans la société. Les questions qui hantaient les surréalistes, dans les années 40 ou les avant-gardes dans les années 70, en Europe, se reposent avec une intensité toute neuve lors des révolutions arabes.
S’agit-il d’accompagner la révolution en cours, au risque d’en devenir un porte-parole dogmatique ? Ismaël avoue s’être posé la question, lors du mouvement consécutif à l’immolation par le feu, à Sidi Bouzid, de Mohamed Bouazizi. Fallait-il vivre la révolution ou la filmer ? Ismaël, à l’image de nombre de ses compatriotes, a choisi de vivre le moment historique, quitte à l’interroger par la suite. Il précise que l’édifice dictatorial mis en place par Ben Ali était déjà sur le déclin depuis plusieurs années.
La nouvelle vague du cinéma tunisien
En témoigne toute une vague, peu connue, d’un cinéma tunisien contestataire qui a pu se développer, dès le début des années 2000, grâce à la mise en place d’écoles et d’universités publiques de cinéma. Créées pour endiguer un chômage endémique, il s’agissait, pour le pouvoir en place, à travers ses structures, de promouvoir un cinéma sous contrôle et de développer des métiers d’avenir, notamment dans le secteur de l’audiovisuel.
Pour Ismaël, un nombre important de diplômés se sont lancés dans une carrière audiovisuelle ou dans la réalisation de films plus ou moins condescendants à l’égard du régime mais une minorité choisit la voie de la contestation. A l’image de Nadia Touijer, qui dans le court-métrage diffusé à l’Uzine, « Le refuge », datant de 2003, met en scène un jeune chômeur survivant en nettoyant des tombes dans un cimetière de Tunis. Film bouleversant, tourné sans autorisation, qui montre le paradoxe d’un pays qui apporte plus de soin aux morts qu’aux vivants. « Les Profondeurs », court-métrage de Youssef Chebi, datant de 2013, raconte de son côté l’errance d’un vampire en pleine phase de reconstruction de la Tunisie.
On peut citer aussi le long métrage incroyable de Jilani Saadi, « Bidoun 2 », tourné en 2013, alors que la société tunisienne s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, en rédigeant une nouvelle constitution. Le film met en scène deux jeunes errants, Aïda et Abdou, dont la dérive enferme tous les possibles. Ce road movie poétique, tourné entièrement en go pro, dérange par la violence latente qui est la sienne. Se pose alors la question centrale de la loi et de la difficulté à trancher entre ce qui relève de la morale et de la politique.
L’homme aux semelles de vent
Ismaël, de son côté, jeune artiste né en 1981, est un poète arpenteur, qui se nourrit des rencontres et des opportunités qui lui sont offertes. Parti, dans les années 2000, étudier la littérature française à l’université du Mirail, à Toulouse ; il rentre très vite en Tunisie réaliser son rêve d’adolescent : celui de filmer, de témoigner d’un regard sur le monde à la fois poétique et humaniste.
C’est ce que nous montrent le prologue et l’épilogue du film Babylon, projetés lors du festival Masnaâ où l’on voit un scarabée aux prises avec un morceau de terre, épars, puis, un camion de vide-ordures venu nettoyer un camp de réfugiés, laissant place à un cimetière de pneus usagers. Ismaël revendique à la fois l’étiquette de cinéaste et celle de poète, ayant publié plusieurs poèmes dans des revues diverses. L’un de ses recueils fut d’ailleurs préfacé par le poète toulousain Serge Pey, connu pour ses performances chamaniques.
Son dernier projet : une collaboration avec le chorégraphe tunisien, Radhouane el Meddeb, que les plus chanceux pourront découvrir au festival de Montpellier danse dans une toute nouvelle création « A mon père, une dernière danse et un dernier baiser ». Le musée Beaubourg ayant, pour sa part, récemment programmé la pièce « Au temps où les arabes dansaient ».
La responsabilité de l’artiste
Ismaël cite souvent l’un de ses maîtres, le cinéaste Jean-Luc Godard dont il admire la capacité à se renouveler, encore à l’âge de 80 ans. « Le numérique est fasciste » affirme ainsi le réalisateur tunisien que ne renierait pas l’auteur des « Histoire(s) du cinéma ». Observant qu’aujourd’hui, « tout le monde utilise les mêmes techniques », Ismaël défend une utilisation « responsable », pour ne pas dire éthique, de la technique mais, ajoute-t-il, « pour dire des choses différentes de ce que les médias nous montrent. »
Celui dont la vocation de cinéaste est née en regardant un reportage de guerre sur France 2 porte un regard neuf, poétique sur le monde qui l’entoure. On pourra méditer sur ces vers libres sur lesquels se clôt un recueil intitulé « lettres à la mort », de 2006, pour mesurer la radicalité d’une écriture qui, comme le dirait Artaud, « gratte le cœur même de la vie » :
« écrire pour décharner / le but / si tant est qu’il y en ait un / est l’anatomie / non pas une page mais une planche / écrire / puis / non pas se couper les veines / mais se fendre les yeux / se vider de son sang / n’est rien / se vider / de son regard ».